Le prix de la résistance
Par Chris Hedges
Truthdig
Lu sur Les Crises
Voici une conférence que Chris Hedges a donné lundi à l’Université de Princeton dans le New Jersey.
Dans les conflits que j’ai couverts comme reporter en Amérique Latine, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Balkans, j’ai rencontré des individus singuliers, de différentes croyances, religions, races et nationalités qui se sont courageusement élevés contre l’oppresseur au nom de l’opprimé. Certains d’entre eux sont morts. Certains d’entre eux ont été oubliés. Beaucoup sont restés inconnus.
Ces individualités, malgré leurs grandes différences culturelles, avaient des traits communs : un engagement viscéral pour la vérité, l’incorruptibilité, le courage, la méfiance face au pouvoir, la haine de la violence et une empathie profonde et indiscriminée, même envers des gens définis par la culture dominante comme des ennemis. Ce sont les hommes et les femmes les plus remarquables que j’ai pu rencontrer en 20 ans passés comme correspondant à l’étranger. Aujourd’hui encore, je m’efforce de mener une vie à leur hauteur.
Vous avez entendu parler de certains d’entre eux, comme Vaclav Havel, que, comme d’autres reporters étrangers, j’ai pu rencontrer presque chaque soir au théâtre de la Lanterne Magique à Prague, pendant la Révolution de Velours de 1989 en Tchécoslovaquie. Vous ne connaissez probablement pas certains des autres, non moins extraordinaires, comme le prêtre jésuite Ignacio Ellacuria, assassiné au Salvador en 1989. Et puis, il y a ces personnes “ordinaires”, bien que, comme le dit l’écrivain V.S. Pritchett, personne n’est ordinaire, qui risquèrent leur vie en temps de guerre en offrant abri et protection à ceux d’une ethnie ou d’une religion opposée qui étaient persécutés ou pourchassés. C’est à certains de ces gens ordinaires que je dois d’être en vie.
Résister au mal radical revient à endurer une vie qui, selon les standards de la société du plus grand nombre, est un échec. C’est défier l’injustice au prix de sa carrière, de sa réputation, de sa solvabilité financière et parfois, de sa vie. C’est mener une existence d’hérétique. Et, peut-être est-ce le point le plus important, c’est accepter que la culture dominante, et même les élites libérales, vous repoussent aux marges et tentent de discréditer non seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. Quand je suis revenu dans les salles de presse du New York Times après m’être fait hué en 2003, pour avoir dénoncé l’invasion de l’Irak et avoir été publiquement réprimandé par le journal pour mon opposition à la guerre, les reporters et les éditeurs de presse que je connaissais et avec qui je travaillais depuis 15 ans, baissaient la tête et se détournaient quand j’étais dans les parages. Ils ne voulaient pas être contaminés par le même virus tueur de carrière.
Les institutions au pouvoir – l’État, la Presse, l’Église, les tribunaux, le milieu universitaire – parlent la langue de la morale, mais ils servent les structures du pouvoir, aussi vénales soient-elles, qui leur procurent argent, statut et autorité. À une époque de détresse nationale – il suffit de regarder l’Allemagne nazie – toutes ces institutions, y compris le monde académique, sont complices par leur silence ou leur collaboration active avec le mal radical. Et nos propres institutions, qui ont capitulé devant le pouvoir des grandes entreprises et l’idéologie utopique du néolibéralisme, ne sont pas différentes. Les individus isolés qui défient le pouvoir tyrannique à l’intérieur de ces institutions, comme nous l’avons vu avec les milliers d’universitaires licenciés et blacklistés pendant l’époque McCarthy, sont purgés et transformés en parias.
Paul Tillich l’a un jour écrit, toutes les institutions, y compris l’Église, sont intrinsèquement démoniaques. Et une vie dédiée à la résistance doit accepter que toute relation avec une institution sera souvent temporaire, car tôt ou tard, l’institution va exiger votre silence ou votre soumission et votre conscience vous l’interdira. Être un rebelle signifie rejeter tout ce qui accompagne la réussite dans un monde capitaliste, dans une culture de consommateurs, en particulier l’idée que nous devrions toujours passer en premier.
Le théologien James H. Cone dans son livre « La croix et le poteau de lynchage » écrit que pour les Noirs opprimés, la croix était un « symbole religieux paradoxal parce qu’il inverse le système de valeurs du monde, par l’idée que l’espoir passe par la défaite, que la souffrance et la mort n’ont pas le dernier mot, que les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. »
Cone poursuit : « Que Dieu puisse ‘faire émerger un chemin d’une impasse’ à travers la croix de Jésus, était vraiment une absurdité pour l’intellect, et cependant une réalité profonde dans les âmes du peuple noir. Les esclaves noirs qui entendirent pour la première fois le message du gospel s’emparèrent du pouvoir de la croix. Le Christ crucifié manifestait l’amour de Dieu et une présence libératoire dans leur vie contradictoire, une présence transcendante dans la vie de ces Chrétiens noirs qui leur donnait la force de croire qu’à la fin, dans l’avenir eschatologique de Dieu, ils ne seraient pas vaincus par les ‘maux du monde’, quelque grave et douloureuse que soit leur souffrance. Croire en ce paradoxe, cette foi en l’absurde, exigeait humilité et repentance. Nulle place n’était laissée aux fiers et aux puissants, à ceux qui croyaient que Dieu les avaient élus pour imposer leur loi. La croix de Dieu était sa réponse au pouvoir – au pouvoir blanc – par un amour impuissant qui arracherait la victoire à force de défaite. »
Reinhold Niebuhr appelle cette capacité à défier les forces de la répression « une folie sublime de l’âme ». Niebuhr a écrit que « seule la folie engagera la bataille avec un pouvoir malfaisant et la ‘méchanceté spirituelle en haut lieu’ ». « Cette folie sublime, comme Niebuhr l’avait compris, est dangereuse mais vitale. Sans elle, ‘la vérité s’obscurcit’ ». Et Niebuhr savait aussi que le libéralisme moral traditionnel est une force inutile dans les moments extrêmes. Le libéralisme, disait Niebuhr « n’a pas l’esprit d’enthousiasme, pour ne pas dire le fanatisme, qui est tellement nécessaire pour pousser le monde hors des sentiers battus. Il est trop intellectuel et trop peu émotionnel pour être une force historique efficace. »
Les prophètes de la bible hébraïque avaient cette folie sublime. Les mots des prophètes hébreux, comme l’écrivait Abraham Heschel, étaient « un cri dans la nuit. Quand le monde est à l’aise et endormi, le prophète sent le souffle de la déflagration divine ». Le prophète, parce qu’ils voit et se confronte à une réalité déplaisante, était comme l’écrivait Heschel, « obligé de proclamer l’exact opposé de ce que son cœur attendait ».
Cette sublime folie est la qualité essentielle d’une vie de résistance. C’est l’acceptation du fait que, quand on se tient du côté des opprimés, on est traités comme les opprimés. C’est l’acceptation que, même si empiriquement tout ce pour quoi nous avons lutté s’est révélé pire, notre lutte se justifie par son existence même.
Daniel Berrigan me dit que la foi est la conviction que le bien attire le bien. Les bouddhistes appellent cela le karma. Mais il me dit, que nous Chrétiens, ne savons pas où ça mène. Nous croyons que ça mène quelque part. Mais nous ne savons pas où. Nous sommes appelés à faire le bien, ou du moins ce que nous pensons être le bien, et ensuite à lâcher prise.
Comme Hannah Arendt l’écrit dans « Les origines du totalitarisme », les seules personnes moralement fiables ne sont pas celles qui disent « c’est mal » ou « il ne faut pas faire ça » mais ceux qui disent « Je ne peux pas faire ça ». Ils savent que, comme Emmanuel Kant l’a écrit, « Si la justice périt, la vie humaine sur terre aura perdu son sens ». Et ceci signifie que, comme Socrate, notre esprit doit être disposé à préférer souffrir qu’à faire le mal. On doit à la fois voir et agir et, sachant ce que cela signifie de voir, il faudra surmonter son désespoir, non par l’usage de la raison mais grâce à la foi.
Dans les conflits que j’ai couverts, j’ai vu la force de cette foi, qui dépasse toute religion ou courant philosophique. Cette foi est ce qu’ Havel appelle dans son grand essai « La force des impuissants » vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité permet d’exposer la corruption, les mensonges et l’hypocrisie de l’état. C’est refuser d’être un rouage du système.
« On ne devient pas un dissident juste parce qu’on décide un beau jour d’embrasser cette carrière des plus inhabituelles » écrivait Havel. « C’est votre sens personnel de la responsabilité qui vous y jette, combiné à un concours particulier de circonstances extérieures. Vous êtes expulsés des structures existantes et mis en conflit avec elles. Cela commence par une tentative de bien faire votre travail et se finit en étant étiqueté comme un ennemi de la société… Le dissident n’agit pas du tout dans le domaine du pouvoir authentique. Il ne recherche pas le pouvoir. Il ne souhaite aucun mandat et ne récolte pas de voix. Il ne cherche pas à charmer le public. Il n’offre ni ne promet rien. S’il a quoi que ce soit à offrir, c’est sa propre peau et il l’offre uniquement parce qu’il n’a aucun autre moyen d’affirmer la vérité qu’il défend. Ses actes ne font qu’exprimer sa dignité de citoyen, quoi qu’il lui en coûte ».
La longue, longue route de sacrifices et de souffrances qui a mené à l’effondrement des régimes communistes s’est étirée sur des décennies. Ceux qui ont rendu ce changement possible sont ceux qui ont rejeté toutes formes de facilité. Ils n’ont pas essayé de réformer le parti communiste. Ils n’ont pas essayé de travailler le système de l’intérieur. Ils ne savaient pas ce que leurs petites protestations, ignorées par les médias officiels, pourraient accomplir ni même si elles accompliraient quoi que ce soit. Mais tout ce temps-là, ils ont tenu bon sur leurs impératifs moraux. Et ils l’ont fait parce que leurs valeurs étaient bonnes et justes. Ils n’attendaient aucune récompense de leur vertu ; et de fait, ils n’en ont reçue aucune. Ils étaient marginalisés et persécutés. Et pourtant, ces poètes, dramaturges, acteurs, chanteurs et écrivains ont finalement triomphé de l’état et du pouvoir militaire. Ils ont attiré le bien vers le bien. Ils ont triomphé parce que, aussi intimidés et brisés que paraissaient les peuples autour d’eux, leur message de défiance n’a pas été inaudible. Il n’a pas été invisible. Le roulement continu du tambour de la rébellion révélait constamment la main morte de l’autorité et le pourrissement de l’État.
Je me tenais parmi des centaines de milliers de rebelles tchécoslovaques à Prague en 1989, durant une froide nuit d’hiver sur la place Wenceslas, quand la chanteuse Marta Kubisova apparut au balcon du bâtiment Meltantrich. Kubisova était bannie des ondes depuis 1968, suite à l’invasion soviétique, en raison de son hymne de défiance « Prière pour Marta ». Sa discographie entière, incluant plus de 200 titres, avait été confisquée et détruite par l’État. Elle avait disparu de l’espace public. Soudain cette nuit-là, sa voix inonda la place. Une foule d’étudiants se pressaient autour de moi, la plupart nés après sa disparition. Ils se mirent à entonner les paroles de cet hymne. Des larmes roulaient sur leur visage. C’est à ce moment que j’ai compris le pouvoir de la rébellion. C’est à ce moment que j’ai compris qu’aucun acte de rébellion, aussi futile puisse-t-il sembler sur le moment, n’est vain. C’est à ce moment que j’ai su que le régime communiste était fini.
« Le peuple va à nouveau décider de son destin » chantait la foule d’une seule voix avec Kubisova. [Note de l’éditeur : pour voir sur YouTube les photographies de la révolution de 1989 et entendre Kubisova chanter cette chanson en studio d’enregistrement, cliquer ici]
Durant cet hiver glacé, les murs de Prague furent recouverts de posters représentant Jan Palach. Palach, un étudiant de l’université, s’était immolé par le feu sur la place Wenceslas, le 16 janvier 1969, au milieu de la journée pour protester contre la chute du mouvement démocratique national. Il mourut de ses blessures trois jours plus tard. L’état tenta rapidement d’effacer son acte de la mémoire nationale. Il n’y eut pas mention de son acte dans les médias d’état. Une marche funéraire organisée par des étudiants fut réprimée par la police. La tombe de Palach, qui était devenue un mausolée, vit les autorités communistes exhumer son corps, incinérer ses restes et les envoyer à sa mère avec l’interdiction de placer ses cendres dans un cimetière. Mais cela ne marcha pas Son acte de résistance resta un cri de ralliement. Son sacrifice poussa les étudiants à agir durant l’hiver 1989. À Prague, la place de l’armée rouge fut renommée place Palach, peu après mon départ pour Bucarest où je suivis le soulèvement en Roumanie. Dix mille personnes vinrent à la cérémonie de consécration.
Nous, comme ceux qui se sont opposés à la longue nuit du communisme, ne disposons plus d’aucun mécanisme au sein des structures formelles du pouvoir qui protégerait ou feraient avancer nos droits. Nous aussi avons subi un coup d’état mené non pas par les leaders impavides d’un parti communiste monolithique mais par l’État-entreprise.
Face à ces conglomérats impitoyables qui détruisent notre nation, notre culture et notre écosystème, il y a de quoi se sentir impuissant et faible. Mais nous ne le sommes pas. Nous avons un pouvoir qui terrifie l’état néolibéral. Tout acte de rébellion, peu importe le nombre de participants ou à quel point il est censuré, rogne un peu du pouvoir néolibéral. Tout acte de rébellion entretient les braises de mouvements plus larges qui lui succéderont. Il passe le relais à un autre récit. Au fur et à mesure que l’État se consumera, cet acte convaincra des gens de plus en plus nombreux. Peut être que cela n’arrivera pas de notre vivant. Mais en nous accrochant, nous maintenons l’espoir que ça arrive. Si nous ne le faisons pas, cet espoir mourra.
Dans La peste d’Albert Camus, le Dr. Rieux n’est pas mû par l’idéologie. Il est mû par l’empathie, le devoir d’accompagner la souffrance, quel qu’en soit le prix. L’empathie, ou ce que le romancier russe Vasily Grossman appelle « la simple bonté humaine » devient dans tous les despotismes, un acte subversif. Agir par empathie – l’empathie pour des êtres humains enfermés dans des cages à moins d’une heure d’ici (à Princeton), l’empathie pour des mères et des pères sans papiers arrachés à leurs enfants dans les rues de nos villes, l’empathie pour les musulmans diabolisés et bannis de nos côtes alors qu’ils fuient des guerres que nous avons provoquées, l’empathie pour les pauvres de couleur abattus par la police dans nos rues, l’empathie pour les filles et les femmes victimes du trafic de la prostitution, l’empathie pour tous ceux qui souffrent aux mains d’un état résolument militarisé et décrétant une cruauté terrible envers les plus vulnérables, l’empathie pour la terre qui nous a vu naître et qui est contaminée et pillée au nom du profit – devient politique et même dangereuse.
Le mal existe. Mais l’amour aussi. Et à la guerre – je pense particulièrement aux moments où les obus s’abattaient sur les foules à Sarajevo, des visions d’horreurs telles que je n’ai plus jamais pu avaler un morceau de viande – alors que les familles cherchaient frénétiquement et désespérément leurs proches parmi les blessés et les morts, on pouvait sentir l’amour et la mort, l’amour et la mort, évoluer en des cercles concentriques, comme des anneaux soufflés par l’explosion d’une fournaise cosmique.
Flannery O’Connor comprenait qu’une vie de foi est vivre une vie de confrontation : « Saint Cyril de Jérusalem écrivait pour l’instruction des catéchumènes : ‘Le dragon se tient au bord du chemin, observant les passants. Craignez qu’il ne vous dévore. Nous nous rendons chez le Père des âmes, mais nous devons passer près du dragon’ ». Quelle que soit la forme que revêt le dragon, c’est de ce passage mystérieux entre ses griffes ou ses mâchoires que naîtront les histoires vraiment dignes d’être racontées, et puisqu’il en est ainsi, il faut, partout et toujours, un courage considérable pour ne pas se détourner du narrateur.
Acceptez le chagrin – car comment ne pas éprouver un profond chagrin devant l’état de notre nation, du monde et de notre écosystème – mais sachez que dans la résistance, il y a un baume qui mène à la sagesse et, si ce n’est à la joie, à un bonheur étrange et transcendant. Sachez que si nous résistons, nous gardons l’espoir vivant.
« Ma foi a été trempée en Enfer », écrivit Vasily Grossman dans son chef d’oeuvre « Vie et destin ». « Ma foi est sortie des flammes des fours crématoires, du béton des chambres à gaz. J’ai vu que ce n’est pas l’homme qui est impuissant dans sa lutte contre le mal, mais le mal qui est impuissant dans sa lutte contre l’homme. L’impuissance de la bonté, de la bonté portée à son point d’absurdité, est en fait le secret de son immortalité. Elle ne sera jamais conquise. Plus stupide, plus absurde, plus impuissante elle parait, plus elle est vaste. Le mal est impuissant devant elle. Les prophètes, les chefs religieux, les réformateurs, les dirigeants politiques et sociaux ne peuvent rien face à elle. Cet amour imbécile et aveugle, c’est le sens de l’humanité. L’histoire humaine n’est pas celle de la bataille du bien contre le mal. C’est la bataille menée par un mal puissant s’acharnant à écraser un petit noyau de bonté humaine. Mais si ce qu’il y a d’humain dans l’être humain a survécu jusqu’aujourd’hui, c’est que jamais le mal ne prévaudra ».

/image%2F0780719%2F20170521%2Fob_98bcb0_medias11.jpg)
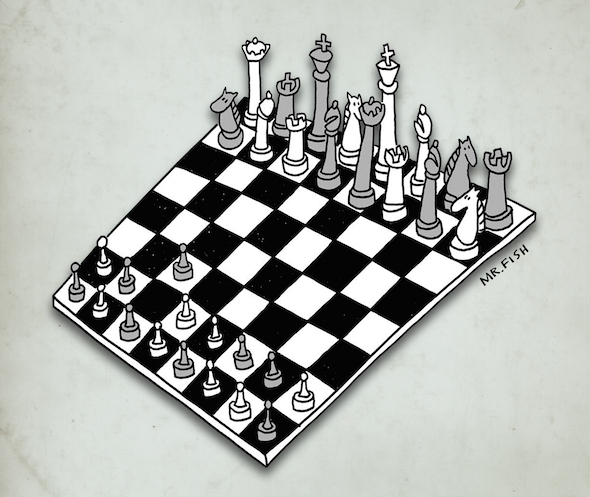


/image%2F0780719%2F20240225%2Fob_efcb79_ftp-moi.jpeg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F-Z9ixgPo36M%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FFkxJd88xkBU%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FEdIQoHXZkvw%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F0780719%2F20240424%2Fob_4d04d9_sunak-kagame2.jpg)
/image%2F0780719%2F20240424%2Fob_b0745d_france-2a.jpg)
/image%2F0780719%2F20240424%2Fob_61b018_panot.jpg)
/file%2F0780719%2F20240424%2Fob_4467b3_schumer1.webp)
/file%2F0780719%2F20240424%2Fob_2a531d_borrell.webp)
/file%2F0780719%2F20240424%2Fob_37e50f_biden23.webp)
 Haut de page
Haut de page